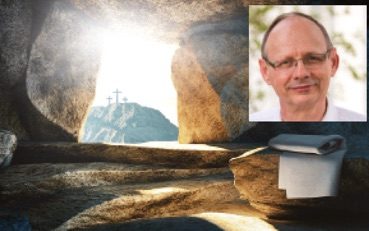Zoom sur le jeûne fédéral
Quand tout un peuple se tourne vers Dieu
L’origine du Jeûne fédéral remonte aux périodes troublées par les guerres, les famines ou les épidémies du 16e et du 17e siècle. A cette époque, des jours de jeûne étaient prescrits par les autorités civiles et religieuses pour des cas spéciaux ou simplement pour remercier Dieu de sa protection. Cette pratique s’enracine dans la tradition chrétienne du repentir collectif, inspirée notamment par ce passage de la Bible: «Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s’humilie, prie et recherche ma grâce, s’il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l’écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays» (2 Chroniques, chapitre 7, verset 14).
Publicité
Une prise de position
En 1572, après la nuit de la Saint-Barthélemy à Paris, des prières sont organisées à Zurich pour les huguenots (protestants réformés français) persécutés. Dès 1619, une première journée commune de jeûne et de prière des cantons réformés a eu lieu après le synode de Dordrecht, pour «rendre grâce à [remercier] Dieu» pour l’unité des chrétiens réformés. En 1643, les cantons catholiques instaurent à leur tour une journée de jeûne et de prière sans toutefois que cette date coïncide avec celle des cantons réformés. En 1796, face à la menace révolutionnaire, la Diète fédérale établit un jour de jeûne pour l’ensemble du pays, mais ce n’est qu’en 1832 que la Diète fixe un jour précis pour cette célébration: le troisième dimanche de septembre, accepté par tous les cantons (à l’exception des Grisons jusqu’en 1848 et de Genève encore aujourd’hui, qui a son propre jeûne deux semaines avant le Jeûne fédéral).
Quelle pertinence dans un pays sécularisé?
Aujourd’hui, si la dimension religieuse laisse place à une signification plus laïque ou sociale, la journée conserve sa portée morale: celle d’une réflexion collective sur les valeurs fondamentales de solidarité, de responsabilité et de cohésion nationale. ▪